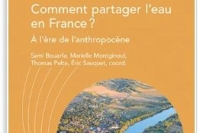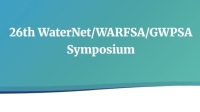L’ordonnance de 1669 « sur le fait des Eaux et Forêts » marqua l’aboutissement d’une lutte séculaire opposant les rois aux seigneurs pour l’appropriation des rivières navigables. Dès lors, Louis XIV se rendit maitre en droit de toutes les rivières navigables du royaume de France, véritables artères vitales du commerce au XVIIe siècle. Cependant, ce droit du souverain sur les rivières rencontra des difficultés pour se traduire dans la réalité. Afin de faire valoir son droit de propriété et surtout garantir les intérêts de la navigation, le souverain désirait exproprier les propriétaires des biens et droits situés sur les rivières navigables. Face à de nombreuses résistances, il dut pourtant se résoudre à les confirmer moyennant le paiement d’une redevance.
À travers une analyse de nombreux actes royaux jusqu’alors inexplorés, cette présentation propose de faire le récit de cet échec qui entraîna la mise en place de redevances sur les rivières navigables et sur les eaux dérivées. Après leur abolition lors de la Révolution française, ces redevances réémergèrent au XIXe siècle sous la forme d'une véritable tarification de l’eau sur les canaux de navigation et les rivières navigables.
Lors du Vendredi Découverte du 12 septembre 2025, Olga Peytavi nous a présenté sa thèse : "Composer avec l'eau dans les communes de Thio et de Touho, en Kanaky Nouvelle-Calédonie”
Résumé : Cette thèse explore les liens vitaux et sensibles entre l’eau et les communautés locales kanak en Kanaky Nouvelle-Calédonie, à travers une enquête de terrain centrée sur les communes de Touho et de Thio. Elle s’attache à comprendre comment l’eau, ressource indispensable à la vie, est vécue, mobilisée et investie dans les dynamiques sociales et territoriales.
L’approche adoptée articule observation de terrain, récits de vie et mémoire collective. L’eau y apparait comme une entité vivante, agissante, qui engage les humains dans des relations de réciprocité et de responsabilité. Elle n’est pas seulement ressource, mais présence car elle circule entre les êtres, traverse les territoires et fonde des liens de cohabitation avec le vivant.
Cette thèse retrace également l’histoire et le quotidien local des réseaux d’adduction en eau, à travers une ethnographie longue des pratiques quotidiennes des habitants dont font partis les fontainiers. L’attention soutenue portée au travail des fontainiers, figures essentielles mais souvent méconnues de la gestion locale de l’eau a révélé une pratique du soin (care) à partir de l’observation au plus près des gestes, des savoirs faire et des ajustements dans leur travail quotidien. Ces récits et ces observations font apparaître des formes de bricolage et d’assemblage qui traduisent une appropriation située des infrastructures.
En croisant ces dimensions, cette recherche montre que l’eau est un révélateur des tensions entre logiques institutionnelles imposées et formes locales d’agencement, de souveraineté et d’attachement au territoire. Loin d’être une simple ressource, l’eau devient un enjeu de justice, un marqueur identitaire mais aussi un partenaire vivant, avec lequel les communautés renégocient sans cesse leurs manières d’habiter et de composer avec le monde.
Dans le cadre du projet DEESAC (Durabilité et exploitabilité des eaux souterraines des aquifères captifs ou sous couverture) financé par le programme OneWater, ce webinaire présente trois cas de gestion concertée des aquifères captifs en France et à l'international.
Les trois cas présentés sont les suivants :
- Les nappes de l’Astien (Hérault, France)
- Le Grand Bassin Artésien (Australie)
- Les nappes profondes de Gironde (France)
L’étude menée dans le cadre du projet a permis d’analyser sur chaque cas :
(i) l'historique de la gestion concertée des nappes captives et la façon dont les différents acteurs ont été progressivement impliqués,
(ii) comment les objectifs de gestion durable ont été définis collectivement, ainsi que les indicateurs de bon état mis en place pour répondre à ces objectifs de gestion durable.
Présentation : Juliette Lafont (CIRAD), étude encadrée par Emeline Hassenforder (Cirad), Laura Seguin, Jean-Daniel Rinaudo & Delphine Allier (BRGM)
La présentation a été suivie d’un temps d’échange entre gestionnaires, chercheurs et partenaires du projet.
Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-22-PEXO-0010 dans le cadre du programme national de recherche OneWater - Eau Bien Commun.
Pour voir la vidéo : cliquez ici
Comment favoriser la réutilisation des eaux usées traitées en France ?
Lors du Vendredi Découverte du 05 septembre 2025 à 11h, Magalie Bourblanc a abordé le thème suivant : « De la politique des algues »
Cette séance était une séance "spéciale Axe 3" - Cette séance portait sur la présentation d’une des 15 planches de BD qui alimenteront le futur ouvrage dans le cadre de l’axe 3 : Informations, Incertitudes, Décisions.
Elle visait la mise en discussion du message porté par cette BD et invitait chacun à se positionner en rapport avec ses propres recherches. La discussion était ouverte à tous. Dans cette planche, Magalie a souhaité partager l’histoire de la prolifération des algues vertes en Bretagne pour illustrer les difficultés pour les gestionnaires d’adapter les recommandations scientifiques aux réalités locales.
La séance a débuté par le retour de Didier Martin sur sa lecture de la planche, puis Magalie nous a présenté plus en détail le message qu’elle a voulu transmettre. Enfin, une discussion a été ouverte à tous les participants qui ont été libres d’exprimer leurs ressentis ainsi que les expériences ou travaux auxquels cela faisait écho.
Vous êtes invités à prendre connaissance de la planche et de l'abstract d’un article à paraître dans la Revue française des affaires sociales (ci-après).

Parution nouvel ouvrage
Face au changement climatique, aux sécheresses qui s’intensifient et aux usages multiples de l’eau, une réalité s’impose : il faut repenser nos façons de gérer et de partager cette ressource vitale !
Parution dans Nature Communications Earth & Environment : une publication sur la source sous-marine de la Vise à Thau.
Un nouvel article scientifique met en lumière la source sous-marine de la Vise à Thau et son phénomène rare d’inversac.
Cette publication couronne des années d’efforts et d’investissements du BRGM et de ses équipes, avec le soutien de la Région Occitanie et de nombreux partenaires financiers, techniques et scientifiques.
- Article de la revue Nature Communications Earth & Environment
- L'étang de Thau lutte contre les intrusions d'eau salée | Sciences et Avenir
- Climat : des chercheurs défient l’inversac I Le Figaro
Le 26e symposium WaterNet/WARFSA/GWP-SA se tiendra virtuellement/en ligne et à Lusaka, en Zambie, du 29 au 31 octobre 2025, sur le thème « Accélérer la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau afin de combler le déficit d'investissement dans le domaine de l'eau d'ici 2030 et au-delà en Afrique australe et orientale ».
Le recensement agricole permet de connaître les grandes tendances de l’irrigation à échéances régulières, notamment en ce qui concerne les équipements mobilisés et les surfaces et les cultures irriguées. L’analyse de ces données constitue une source complémentaire de connaissances sur l’irrigation en France métropolitaine, à différentes échelles administratives et hydrographiques.