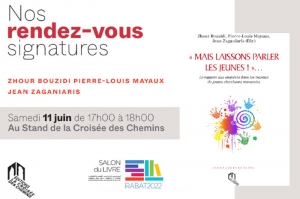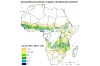Dans 5 régions rurales de Tunisie, 4000 personnes de tous horizons ont contribué à un vaste processus de planification territoriale participatif.
Le remue-méninges ARID est destiné à faire réfléchir sur un thème donné, au-delà des idées qui viennent immédiatement à l'esprit. La réalité est souvent bien plus complexe et plus surprenante que les discours convenus.
Le 10 Juin 2022 à 11h, Claire Dabas a présenté ses travaux intitulés "Mettre en débat et évaluer la résilience territoriale et la capacité d’adaptation au changement climatique de territoires ruraux tunisiens"
Résumé :
Mon stage porte sur la question de la résilience territoriale. Il se déroule en Tunisie dans le cadre du programme d'adaptation au changement climatique des territoires ruraux vulnérables (PACTE). Le programme PACTE vise à accompagner l'élaboration de plans d'aménagement du territoire via une démarche de diagnostic et de planification participatifs. Mon travail porte sur la dimension sociale de la résilience territoriale. J'interroge la notion même de résilience territoriale telle qu'elle est pensée par la recherche scientifique et perçue par les acteurs locaux. Je m'intéresse donc aux questions de solidarité territoriale, d'attachement au territoire, d'entraide, et de liens sociaux qui sous-tendent la résilience des populations dans les zones PACTE. Mon travail passera par des entretiens et des ateliers avec le comité de territoire de Bizerte, un des terrains du programme PACTE. L'ambition de mon travail est également de questionner dans quelle mesure cette méthode d'évaluation de la résilience territoriale pourrait être mobilisée ailleurs.
" Que nous révèle la relation d’enquête en sciences sociales -ces rapports très variés qu’un chercheur noue et entretient avec ses enquêtés- sur le fonctionnement d’une société ?
C’est l’association d’une production agricole et électrique avec des panneaux solaires.
Les panneaux, outre la production électrique, permettent une protection partielle des cultures contre les excès du climat, avec un objectif de réduire l’évapotranspiration et donc les consommations d’eau. La qualité de certaines productions à haute valeur ajoutée (fruits, légumes, vigne) peut s’en trouver améliorée.
Ces pratiques prévoient de limiter le travail du sol, de faire des rotations longues et de conserver un sol couvert en permanence.
On cherche à mieux comprendre comment de telles pratiques peuvent être mises en œuvre en conditions Méditerranéennes, avec de l’irrigation en goutte à goutte enterré comparée à l’aspersion. L’objectif est de qualifier l’efficience d’utilisation de l’eau de telles pratiques, qu’il s’agisse d’eau de pluie ou d’eau d’irrigation, pour mieux en conseiller le développement.
La performance des techniques d’irrigation
Le laboratoire permet d’évaluer les différents déterminants des performances des dispositifs d’irrigation, qu’il s’agisse des goutteurs ou des asperseurs, que l’on travaille avec des eaux propres ou des eaux usées traitées. Les questions traitées ont trait à la sensibilité aux colmatages, au transport par le vent ou à l’évaporation au service d’une meilleure efficience d’utilisation des eaux, dans un objectif d’économie.
Sur la plateforme expérimentale de Murviel-Les-Montpellier, on évalue différentes pratiques d’irrigation en conditions de plein champ et en conditions contrôlées sous serre.
L’objectif est de tester la faisabilité technique de dispositifs innovants de traitement des eaux usées et la durabilité des systèmes d’irrigation d’un point de vu bio-colmatage. Les impacts sont également analysés sur les plantes et les sols, en terme de dissémination et de survie des de pathogènes, ou de dissémination des micropolluants, ou encore de rendement et de salinisation des sols. On travaille à la fois avec des eaux usées traitées règlementaires et des eaux usées moins contrôlées.