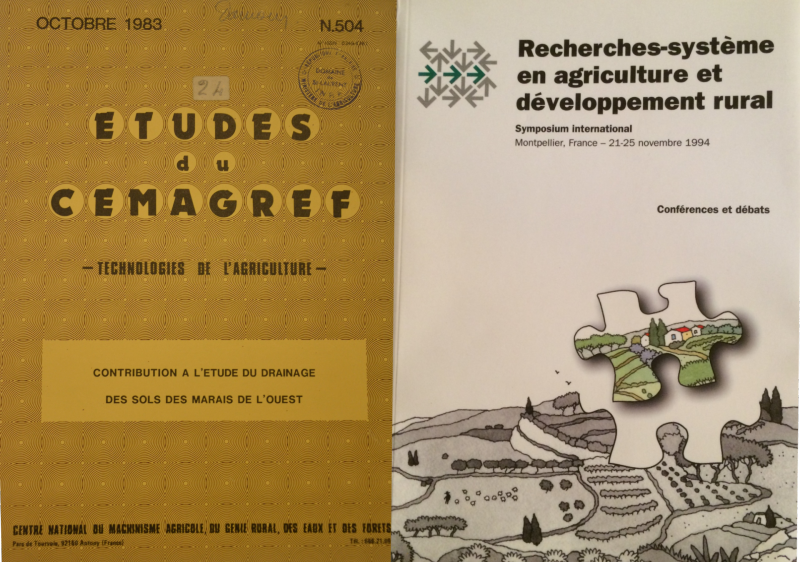 Vendredi 03 décembre 2021 à 11h00, Pierre Cornu, Professeur d’histoire contemporaine & d’histoire des sciences, Université Lyon 2 / Inrae, a présenté ses travaux intitulés "L’émergence de la question environnementale dans la recherche publique française. Leçons et perspectives d’un chantier d’histoire collaborative".
Vendredi 03 décembre 2021 à 11h00, Pierre Cornu, Professeur d’histoire contemporaine & d’histoire des sciences, Université Lyon 2 / Inrae, a présenté ses travaux intitulés "L’émergence de la question environnementale dans la recherche publique française. Leçons et perspectives d’un chantier d’histoire collaborative".Résumé :
Inscrite dans une tradition remontant au programme des Lumières et à sa traduction ingénieriale au 19e siècle, la recherche française sur l’agriculture, l’eau et la forêt s’est trouvée dans une situation paradoxale au moment de la mise à l’agenda de la question environnementale au tournant des années 1970. D’un côté en effet, les grandes écoles spécialisées et leurs laboratoires, l’Inra et les grands instituts techniques (Ctgref, Cneema, etc.) pouvaient se prévaloir d’une expertise au long cours sur la gestion des ressources et le développement des territoires. Mais d’un autre côté, ces organismes se trouvaient directement mis en cause par la critique du « progrès » scientifique et technique dont étaient porteuses les formes nouvelles d’engagement pour l’environnement. Ce n’est cependant pas selon une ligne de faille entre chercheurs et citoyens que le débat s’est organisé, mais dans une réflexion critique à la fois interne et externe à la recherche sur les limites de la rationalisation économique des bioressources, à l’origine d’un profond renouveau épistémologique et axiologique de la recherche publique. Le développement de l’interdisciplinarité, des approches systémiques et du dialogue sciences-société s’est ainsi nourri des questions environnementales autant qu’il a contribué à les structurer.
Initié au sein du Comité d’histoire Inrae sur les questions agricoles métropolitaines dans un premier temps, ce questionnement s’ouvre aujourd’hui à une perspective à la fois plurithématique et transnationale, qui place au centre de ses interrogations l’impact de la question environnementale sur la relation entre recherche, société et territoires dans l’anthropocène. C’est donc à identifier les questions et les ressources d’un tel chantier que cette présentation sera consacrée.
















