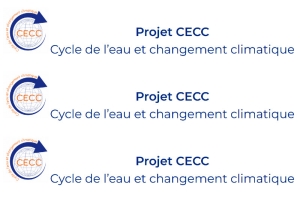Le séminaire ICIREWARD-Sciences Sociales organisé par l’UMR GEAU en partenariat avec le Centre Unesco de l’Eau de Montpellier, le vendredi 5 décembre 2025 de 10h à 12h30 sur le site HYDROPOLIS Lavalette (rue Jean-François Breton, Montpellier) - salle Aquadémie, traitait du sujet suivant : Penser la robustesse de l’eau
En présence de :
Olivier Hamant est directeur de recherche INRAE au laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes (RDP) à l'ENS de Lyon,
Marcel Kuper est directeur de recherche CIRAD à l’UMR G-EAU (Gestion de l’Eau, Acteurs et Usages) à Montpellier.
Dans le domaine de l’eau, la recherche de l’optimisation et de l’efficience pour s’adapter face aux effets du changement climatique fait débat, aussi bien en termes de durabilité, d’efficacité que de justice environnementale.
Cette séance du séminaire ICIREWARD-SHS Unesco a pour objectif d’alimenter ces réflexions autour de la question de l’eau en mettant en regard le concept de « robustesse » proposé par Olivier Hamant : « qui se construit d’abord sur l’hétérogénéité, la redondance, les aléas, le gâchis, la lenteur, l’incohérence… bref, contre la performance »*, et une réflexion empirique de Marcel Kuper élaborée à partir de nombreux travaux de terrain menés au Maghreb, qui mettent en lumière les implications concrètes des politiques d’efficience dans le domaine de l’eau agricole.
*Hamant, O. 2023, Antidote au culte de la performance. La robustesse du vivant. Tracts, n°50, Gallimard.