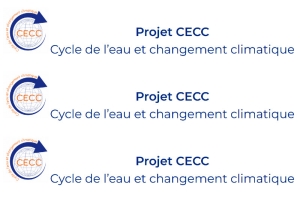Les interactions entre les eaux de surface (SW) et les eaux souterraines (GW) sont complexes et peu étudiées, bien qu'elles influencent significativement la recharge des nappes et la résilience des cours d'eau. Les conditions hydroclimatiques sont des moteurs essentiels pour ces flux d'eau, mais la pression anthropique a également un impact croissant sur leur évolution. Pour être capables de modéliser correctement les processus qui contrôlent ces interactions, des observations de terrain à haute résolution et sur de longues périodes sont indispensables.
L'objectif de la thèse est d'approfondir la compréhension des relations SW/GW, en examinant leurs variations spatio-temporelles, tant à l’échelle régionale qu’à celle de l’hydrosystème. Le premier axe de recherche se concentrera sur l'identification des facteurs qui expliquent les variations spatiales et temporelles (par une analyse des tendances) des interactions entre cours d’eau et nappes, à l’échelle régionale. Le second axe consistera en une analyse détaillée des processus à l'échelle de plusieurs hydrosystèmes (observatoires), afin de tester et valider des approches de modélisation.
Les résultats de ces travaux fourniront une description des facteurs de contrôle des interactions SW/GW et de leur impact sur la ressource en eau souterraine, en prenant en compte les pressions anthropiques. La thèse s’appuiera sur les réseaux d’observations des bases de données hydroclimatiques publiques nationales à l’échelle régionale et sur le réseau des observatoires OZCAR & Zones Ateliers à l’échelle des hydrosystèmes.
Un partenariat est mis en place dans l’encadrement de la thèse entre 3 unités : UMR G-Eau (BRGM DE/AKS Montpellier – JB Charlier & Y Caballero), BRGM DE/AS Orléans (D Allier), et l’INRAE Riverly de Lyon (E Sauquet).
Cette thèse est financée par le programme Water4All.
Mots-clés : Ressources en eau, tendances, hydrologie, approche multi-échelles, observatoires